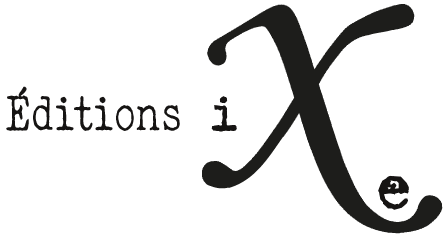Dans cette recension parue dans le numéro de février de la revue Études, Camille de Villeneuve passe en revue quatre titres récemment publiés, dont La querelle des femmes, d’Éliane Viennot.
Quatre ouvrages récemment parus font suite au mouvement #MeToo dans un effort de clarification savante et d’engagement. Trois d’entre eux proposent un détour minutieux par l’Histoire et éclairent le présent d’une lumière crue. Le quatrième, plus personnel, incite chacun à considérer ses représentations du genre, de la domination et de la violence comme autant de constructions culturelles qu’un regard sincère posé sur autrui peut déplacer.
En octobre 2018, Michelle Perrot et Laure Murat invitaient à «déconstruire la galanterie à la française». Alain Viala saisit la balle au bond et propose dans La galanterie, une mythologie française un voyage en dix-sept vignettes emblématiques des motifs galants déclinés en France du XVIIe au XXe siècle. Conclusion de l’auteur: il y a plusieurs galanteries. Et d’inviter les «pour» ou les «contre» à s’expliquer avant tout débat sur ce qu’ils entendent par là. La «galanterie française», telle qu’elle est vantée dans des ouvrages récents, est une invention nationaliste et réductrice d’un thème littéraire plurivoque, qui contribua à aménager la domination masculine plus qu’elle ne servit des échanges réciproques et égaux.
L’Histoire est encore un recours dans le livre d’Éliane Viennot consacré à la «querelle des femmes», dont l’auteure montre qu’on ne saurait la cantonner à une note de bas de page de manuel académique. L’histoire littéraire et l’Histoire tout court ont plongé dans l’oubli cette masse de littérature misogyne apparue au XIVe siècle et débattue au fil des siècles par de rares hérauts de la cause féminine tels Corneille Agrippa, Pontus de Tyard ou François Poullain de La Barre. Car rien n’arrêta ce flux inédit de vulgarité antiféminine à l’origine de la querelle entre ennemis et amis des femmes, pas même les Lumières. Éliane Viennot propose une interprétation de ce phénomène minimisé par les historiens. La fondation des universités à la fin du Moyen Âge obligea l’Église et les clercs à assurer leur pouvoir contre tout élément allogène, dont les femmes et les Juifs. Éliane Viennot rend ainsi compte du lien étroit entre la misogynie et l’antisémitisme. Mais, au-delà de son intérêt historique, son livre s’impose par la ferveur de son engagement contre cette culture de la querelle qui continue, selon elle, d’animer sourdement les débats sur la domination masculine. Si personne ne peut plus dire au sujet de la femme, comme Voltaire, qu’elle est un «animal» à qui la nature «a percé au bas de l’abdomen un si vilain trou» (cité p. 44), l’intention misogyne demeure dans la frilosité à juger des crimes contre les femmes et dans la résistance à tolérer qu’elles exercent les fonctions jusqu’alors réservées aux hommes.
Geneviève Fraisse, dans La suite de l’Histoire, propose d’explorer la voie difficile de l’émancipation féminine par la création. Si les femmes ont conquis leur liberté en acquérant la citoyenneté, l’émancipation des femmes artistes reste en devenir. Il leur faut lutter contre les séquelles d’un discours selon lequel les femmes, trop superficielles et tournées vers elles-mêmes, ne peuvent être des créatrices sérieuses, discours qui leur ferma longtemps les portes des écoles d’art et des académies. Geneviève Fraisse retrace en quelques pages passionnantes le destin de femmes artistes qui, malgré les obstacles, ont tenté de construire une oeuvre. On regrette la distinction, à nos yeux trop radicale, entre deux voies de l’émancipation féminine, citoyenne et personnelle, qui sont en étroit rapport. Les conditions politiques et économiques ont des effets immédiats sur la capacité d’une femme à mener une vie d’artiste. À cette réserve près, ce livre convainc qu’au-delà des droits à conquérir, il y a une symbolique à défaire, celle qui, pendant des siècles, a exclu les femmes. Les artistes sont les premières requises pour cette tâche.
Le texte de Carolin Emcke complète enfin harmonieusement ces ouvrages érudits (lire l’entretien dans Études n° 4267, janvier 2020, pp. 51-61). Plus intime, il se présente sous la forme d’une méditation libre sur les effets de #MeToo. Pourquoi tant de résistance à reconnaître la parole d’une femme? Pourquoi est-il si ardu de faire place à la souffrance d’autrui? À travers ses propres anecdotes et ses souvenirs, l’auteure invite le lecteur à remettre en question ses représentations du viable et du supportable. Elle consacre quelques pages à la photo d’un jeune garçon pakistanais qu’elle rencontra lors d’un reportage en Afghanistan. C’était au début de la guerre, en 2001. On voit l’enfant rapiécer des vestes d’uniforme. À ce moment-là, la journaliste croyait qu’il s’agissait du domestique d’un groupe de soldats afghans. Elle apprit plus tard qu’il était l’un de ces garçons esclaves, y compris sexuels, que les «seigneurs de la guerre» se procuraient parmi les plus jeunes de leurs prisonniers, «objets bons à tout faire, abusés, harcelés, violés». La rencontre avec cet enfant ne sera, pour elle, jamais terminée. Il est pénible d’être le témoin impuissant de la souffrance d’autrui. C’est pourquoi l’ouverture à l’altérité est si difficile. C’est pourtant le chemin sans fin de l’éthique. Carolin Emcke dit aussi qu’au-delà des enjeux immédiats de #MeToo, c’est notre vie morale qui est en question.