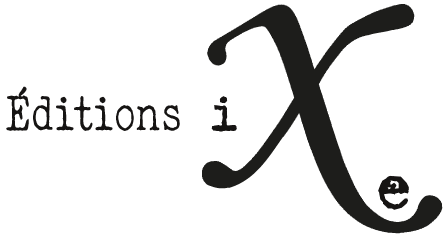Que dire de Constellations subjectives. Pour une histoire féministe de l’art ? D’abord que ce volume est important. Ensuite qu’il paraît 10 ans après une autre anthologie de référence dans le paysage français – La Rébellion du Deuxième Sexe – éditée par Fabienne Dumont qui a porté la première, en 2011, ce nécessaire travail d’exhumation, de contextualisation et de traduction de textes formalisant l’avènement, depuis les années 1970, d’une histoire de l’art retravaillée par les théories féministes et au-delà. Constellations subjectives peut être vu comme son prolongement tout en en élargissant le spectre théorique et géographique qui, il faut le reconnaître, s’est fortement consolidé en 10 ans. Il réunit 16 essais, écrits non seulement par des historiennes de l’art, de l’architecture, du cinéma, mais aussi par des artistes, critiques, conservatrices et enseignantes, autant de médiatrices qui œuvrent à tous les niveaux de production et de diffusion de l’art. La réunion de cet écosystème militant, irrigué par une multitude de perspectives, de contextes et de supports, s’enracine néanmoins dans l’histoire de l’art, une discipline commune aux quatre coordinatrices de l’ouvrage.
Par leurs trajectoires respectives comme par leurs synergies, ces chercheuses incarnent la vitalité de l’art contemporain à l’université Rennes 2 ; cela notamment grâce à l’action déployée depuis plus de 10 ans par Elvan Zabunyan, qui en a fait un lieu de redéfinition de l’histoire de l’art via l’étude de ses marges. Ce travail en est un exemple. D’abord initié en 2015 dans un colloque, le sujet a depuis été enrichi et transformé en un ouvrage collectif publié en 2020 par les éditions iXe d’Oristelle Bonis dont le travail au service des savoirs féministes mérite d’être salué.
Et parce que ces savoirs « émancipés » ou « indisciplinés » se trouvent aujourd’hui menacés et mal compris dans notre pays, le cadre théorique et épistémologique que Marie-Laure Bonilla, Émilie Blanc, Johanna Renard et Elvan Zabunyan posent en préambule, est absolument nécessaire. Leur introduction s’énonce en mots-clés comme autant de socles interchangeables à partir desquels il est possible de tisser des constellations. Historicité, subjectivité, encorporation, intersectionnalité, décolonialité : tous ces mots résonnent ensemble pour former un plaidoyer en faveur d’une histoire de l’art ouverte, sensible, en mouvement mais aussi en prise avec son temps. À l’intérieur de ce lexique, des mots ont tout particulièrement été choisis pour structurer l’ouvrage en quatre parties.
La première « Récits/Engagements » s’ouvre sur un texte de Griselda Pollock, devenue malgré elle une figure canonique de l’histoire de l’art, elle qui en 1999 attaquait justement son canon. Ce texte agit comme un manifeste en faveur d’un féminisme, non pas empêtré dans une définition restreinte qui l’associerait uniquement au féminin et à sa différence avec le masculin, mais bien comme un vigoureux contre-pouvoir régi par la transversalité, le décentrement, l’ellipse et la potentialité. En reconsidérant une exposition de Catherine de Zegher, Pollock envisage la différence comme un espace de convergence des différences géopolitiques et des subjectivités esthétiques ; espace qui, loin d’être uniforme, doit néanmoins s’unifier pour devenir force. Et pour que ce projet politique émerge, il faut en passer par une critique de l’ordre en place comme le soutient Katy Deepwell dans son article sur l’année 1989, une année qui a longtemps constitué un point historique de fléchissement de l’art contemporain vers la mondialisation. Au même moment, et notamment grâce à sa revue n. paradoxa, Deepwell constate la mise à l’écart de certain·e·s artistes et subjectivités qui peinent à entrer dans une culture de l’entre-soi. Repensant également les historiographies, les textes de Stéphanie Dadour et de Clélia Barbut s’intègrent à ce processus de réécriture des récits en examinant, pour l’une les pensées du décentrage dans le champ architectural des années 1980-1990, pour l’autre la difficulté à conserver les actions des performeuses féministes des années 1970. En leur redonnant la parole grâce à des entretiens, Barbut pointe les méprises qui ont pu façonner l’histoire de ces performances données dans l’instant et dont la pérennité demeurait un impensé. Au fil du temps, l’absence de reconnaissance qui auréolait ces artistes les a poussées à combler ce vide documentaire. S’il est important de réparer les oublis au sujet des artistes, il est tout aussi important de le faire pour les institutions et expositions qui constituent un autre mode d’écriture de l’histoire de l’art. En revenant sur l’un des seuls centres féministes en art contemporain d’Amérique du Nord – La Centrale Galerie Powerhouse – fondé en 1973 à Montréal, Virginie Jourdain pointe l’œil sur ce centre pionnier pour la visibilisation des pratiques artistiques féministes. Par sa programmation inclusive ou son autogestion par les artistes, La Centrale s’est imposée comme un contre-modèle au musée moderniste et à sa prétendue neutralité.
La deuxième partie du livre, intitulée « Encorporations/Savoirs », questionne les modalités rhétoriques de transmission des savoirs féministes en explorant la puissance critique de supports spécifiques. Plaçant sa conférence-performance sous les auspices providentiels des sibylles, Anne Creissels réfléchit sur ce que le savoir fait au corps et a contrario ce que le corps fait au savoir. À l’encontre d’une connaissance prétendument objective, elle défend une vision située, faite de chair et d’os, et performative dans la droite lignée d’un art corporel qui a historiquement incarné l’expression d’une subjectivité féministe. C’est également à des penseuses-praticiennes faisant converger activisme, performance et cinéma que Muriel Andrin consacre son essai aux manifestes pornographiques féministes. En tant que dispositifs textuels ou visuels, ils sont redoutables pour dénoncer dès les années 1980 la pornographie comme objet de régulation des corps et se réapproprier un discours où s’est propagé l’asservissement des femmes. Souvent critiques envers un féminisme qu’elles jugent convenable et dans lequel elles ne se reconnaissent pas, ces militantes sont pourtant proches de femmes qui dans les années 1970 ont relayé les voix de celles et ceux que l’on n’entendait pas (ouvriers, pauvres, immigré·e·s). Nil Yalter et Lea Lublin se rencontrent à Paris en 1973, elles se retrouvent dans des collectifs d’artistes femmes, des expositions, deviennent amies en partageant des histoires et des idées communes. Dans son portrait croisé, Fabienne Dumont fait émerger les convergences entre ces passeuses d’une culture populaire aux mondes élitistes de l’art, à une période où l’intersectionnalité existe sans toutefois être conceptualisée comme telle.
Dans ce sillage, les deux dernières parties du recueil réaffirment l’importance d’écouter des voix parlant à partir d’autres contextes culturels, intellectuels et politiques que ceux uniquement occidentalocentrés. Reconnaissons que ces champs d’études (études de genre et postcoloniales, études culturelles et visuelles…) se sont d’emblée constitués à la faveur d’un dialogue transatlantique entre l’Europe et l’Amérique du Nord dont les discours sont devenus hégémoniques au fil du temps. À bon escient, la troisième partie intitulée « Ex/centriques/Corporéités » porte à notre connaissance des artistes qui ont conquis l’image comme un lieu à elles autorisant les résistances. L’utilisation de rhétoriques visuelles agit alors pour interpeler, bousculer et faire réfléchir sur les logiques de dominations multiples qui forgent les assignations. À partir du postulat que le vêtement fonctionne comme interface entre l’intérieur et l’extérieur, Lisa Petiteau démontre comment des Indiennes (artistes et activistes) s’emparent du traditionnel sari pour dénoncer et performer les inégalités sociales entre les sexes. Aurélie Jourdain-Duez nous emmène, quant à elle, du côté d’une histoire des Indiens d’Amérique revisitée, grâce à l’œuvre plurimédia de l’artiste Wendy Red Star, où sont déconstruits et parodiés les fantasmes autour des femmes autochtones. Portant sur l’Afrique du Sud, les essais de Melanie Klein et de Dominique Malaquais élargissent le périmètre des représentations et identités de genre en s’intéressant aux lesbiennes, transexuel·le·s et intersexes rendu·e·s visibles dans les photographies de Zanele Muholi et les dessins et vidéos de Gabrielle Le Roux. Souvent réalisées de concert avec les personnes représentées, ces œuvres archivent plus largement des vies qui, chaque jour, se heurtent dans leur pays au rejet et à l’incompréhension.
Pour finir, la quatrième partie « Décolonialités/Constellations » nous invite à retrouver un espace d’échange, d’écoute et de compassion autour de communautés qui contestent l’ordre capitaliste, néolibéral et colonialiste. Par l’intermédiaire de María Galindo, le groupe Mujeres Creando livre un programme combattif pour penser concrètement un mouvement féministe en action dans la Bolivie d’aujourd’hui. Faisant peser la responsabilité sur les ONG et leur reconduction d’un système technocratique qui brime l’émancipation des femmes, Mujeres Creando plaide pour l’élaboration d’un langage propre et une réappropriation de l’espace de la rue. Si avec leur performance Diásporas Críticas elles défendent le support sonique-poétique et une polyphonie par le corps pour délivrer leur message anticolonialiste, Nataliya Tchermalykh examine dans un essai les résistances d’artistes femmes russes et ukrainiennes face à la violence de l’ingérence russe lors du conflit de 2014. La cinéaste-enseignante Dalida María Benfield clôt le recueil avec une analyse intime et politique de ce que permettent des nouveaux médias connectés et solidaires. À l’encontre d’un cyberespace qui a pu favoriser un regard colonisateur, elle invite à garder vives les mémoires que nos corps portent en tant que sujets coloniaux et décoloniaux.
En refermant ces pages où nous avons voyagé entre les pensées, les subjectivités et les engagements de ces autrices, nous nous sentons revigoré·es. Ce parcours stimulant, qui invite à se lever, à dire les vulnérabilités, à réparer des injustices, à nouer des solidarités, nous ressource. Il nous fait du bien nous qui, empêché·e·s et confiné·e·s, sommes dans l’attente du monde d’après.