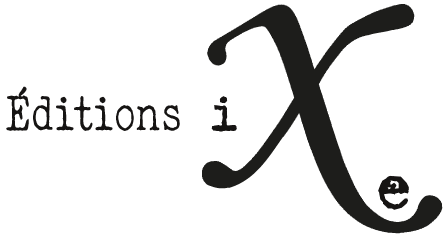Pour la rédaction de cet ouvrage, les auteur.es ont choisi un format très particulier. S’attaquant aux « dogmes » édictés par l’institution que représente l’Académie française et ses quarante « immortel.les », le livre proposenon sans une certaine ironie, un parti pris polémique, en filant dans ses intitulés à charge, la métaphore religieuse (catholique). L’organisation de l’ensemble se fait ainsi, dans l’ordre suivant : tout d’abord, une présentation historique de l’institution critiquée, désignée par « le Saint-Siège » (p. 13-64) ; viennent ensuite « les offenses » (p. 65-78) – à savoir, les réactions négatives exprimées – puis, au centre, « les points de doctrine » (p. 79-104), qui présentent « une liste des douze dogmes qui lui servent de feuille de route » (p. 11). Cette partie pointe les arguments récurrents fondateurs du discours des académicien.nes. Il y est ensuite question « des bulles » (p. 105-122) (constituées de ses déclarations officielles) ; suivent « les exégèses » (p. 123-174), « les suppliques » (p. 175-192) et enfin en guise « de synthèse à cette guerre sainte menée contre l’égalité des sexes et contre la langue française », un « chapelet des perles » (p. 193-196). L’organisation suivie par la suite au sein de chaque chapitre consiste à renvoyer en marge à des points très précis abordés à d’autres endroits de l’ouvrage. Ces renvois divers et assez systématiques, qui ne sont pas toujours évidents à suivre pour les néophytes en la matière, sont néanmoins très utiles à l’analyste de discours et permettent de pister sa construction.
Si la première partie du livre dénonce une institution aujourd’hui devenue surtout folklorique tout autant que coûteuse, la seconde partie – composée essentiellement des « exégèses » (p. 123-174) suivies des « suppliques », (p. 175-192) – décortique les interviews et déclarations écrites signées par les académiciens contre la (re)féminisation) ou démasculinisation de la langue. L’ensemble de ces textes annotés est paru dans la presse entre 1984 et 2005, soit au moment de la création et des travaux de la commission de terminologie (créée par décret du 29 février 1984, p. 106), soit au moment de la publication de Femme, j’écris ton nom… paru en 1998. Cette partie, parfois redondante, car les exemples utilisés sont toujours les mêmes, est néanmoins nécessaire et didactique. Après certains rappels sur son ou ses auteurs, elle reproduit le texte dans son intégralité. Les analyses qui en sont proposées en notes montrent la volonté de confusion brandie par ces plumes, en particulier entre le genre masculin et féminin des inanimés (dont il n’a jamais été question) et des animés.
La couverture de l’ouvrage, illustrée d’un dessin de Louise Labé faisant un clin d’œil, inscrit d’emblée dans la dimension diachronique la grande absence des femmes de cette institution et indique le parti pris d’un humour polémique, parfois ironique, mais toujours très scientifique et documenté. L’écriture est néanmoins parfois teintée d’une attaque acerbe (p. 49) qui peut interroger. Les académicien.nes ne sont-ils pas eneffet les simples utilisateurs opportunistes d’une institution qui existe, telle quelle ? Ne conviendrait-il pas, plutôt, de s’en prendre à l’institution elle-même qui, probablement, n’a plus aujourd’hui d’autre raison d’exister qu’un certain folklore rituel prestigieux qu’elle représente, un peu comme les autres monuments ?
Dans cet ouvrage de 216 pages divisé en sept grandes parties, les auteures (je choisis ici par facilité l’accord de nombre au féminin, afin de représenter quatre autrices et un auteur) choisissent plus particulièrement de s’attaquer à deux faits : d’une part la « très longue absence des femmes de chair et d’os dans cette confrérie » et d’autre part, « son activisme en faveur de la masculinisation de la langue française », en particulier celle des titres (p. 13).
La partie intitulée « Le Saint-Siège » retrace ainsi de manière très documentée et chronologique l’histoire de l’Académie française, depuis son surgissement – dû aux réunions régulières de fidèles de Malherbe qui avaient fini par obtenir le soutien de Richelieu en échange d’une forme de droit officiel à débattre des règles littéraires et ses causes, jusqu’à ses disparitions, refondations, et soubresauts pour résister à l’entrée des femmes en son « saint » (sein ?!), au cours de cette histoire, jusque dans les années 1980, avec Marguerite Yourcenar. Une comparaison y est faite avec les autres Académies, créées plus tardivement, les évolutions du costume, dues à Bonaparte, le renforcement – inattendu – de la masculinisation suite à la Révolution française d’une part, puis au code civil de 1804 ensuite. Mais surtout, elle explique que progressivement, le rôle principal qui lui est dévolu : réaliser un dictionnaire de la langue française, qui n’était au départ que l’une parmi d’autres de ses missions, et assez loin dans la liste de ses raisons d’existence, devient assez anecdotique, pour ne pas dire folklorique, par la lenteur de sa rédaction et la dimension sporadique de ses éditions face aux autres dictionnaires qui fleurissent au fur et à mesure que se développent l’édition et l’impression. Par ailleurs, elle ne put jamais jouer le rôle initialement imaginé par Richelieu de « régenter la vie littéraire et édifier une littérature « canonique » (p. 46).
Finalement, le grand défaut des académicien.nes est d’être avant tout des humains lettrés, néanmoins non linguistes, ayant une vision dogmatique et conservatrice de la langue et de la société – comme pour préserver les « belles » lettres contre diverses (fausses) attaques des usagers de la langue. Le vrai débat reste en réalité celui souvent abordé du purisme et dont la masculinisation n’est que l’un des volets – certes majeur – avec la chasse aux anglicismes (p. 43). L’ouvrage se distingue ainsi par son abord très historique de la langue, des faits et des faits de langue, s’appuyant surune analyse énonciative et de discours – qui part du principe que si un académicien dit quelque chose, il le dit au nom des quarante membres de l’Académie, et qu’un texte signé de la Secrétaire perpétuelle Carrère d’Encausse, le fait également. Il y a donc ce côté « bloc » qui semble caractériser la chose. Néanmoins, les signataires sont souvent des individus, masculins, et souvent les mêmes. Et l’on comprend au fil du texte par de subtiles mises en parallèle de propos, que certains prennent plus à cœur leur tâche réelle que d’autres (p. 48), mais en quoi et comment néanmoins, l’institution telle qu’elle existe est à la fois sexiste et inapte à donner un avis, qui relève du folklore et non de la science. Le combat de la masculinisation aujourd’hui semble ainsi être surtout le fait de certains éléments, à qui il peut tenir à cœur, et que les autres laissent parler peut-être sans vraiment leur donner leur aval, par « sympathie » de caste ou juste, « si ça leur fait plaisir… ». Chacun en effet, ayant plus à cœur ses affaires propres, qu’un débat sur la langue qui ne peut que les dépasser.
Ainsi, fondamentalement, les autrices nous proposent avant tout un ouvrage multichamps : car il s’agit également ici de politique linguistique, du rapport entre langue et pouvoir, de sociolinguistique et, tout simplement, de politique… On peut ainsi citer pour conclure, ce passage qui synthétise l’esprit : « L’Académie française a travaillé à faire du masculin le genre grammatical devant lequel l’autre devait soit montrer sa soumission, soit disparaître purement et simplement. Elle a donc activement secondé, sur le terrain linguistique, l’entreprise menée sur le terrain philosophique et scientifique pour faire de « l’homme » (au singulier) le représentant de l’espèce humaine » (p. 37).