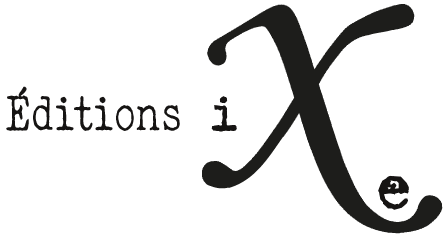Cet obscur objet de violence: le corps féminin dévoré
Enjamber la plaque où se reflète l’enfer. Un récit sur le viol est un joyau de courage et d’écriture dans un écrin particulièrement soigné des éditions iXe : c’est ce que nous offre Souad Labbize, un petit livre 10×13 que l’on garde dans le creux de la main tant il faut avancer à pas comptés dans sa lecture. Pour les lecteurs bilingues, c’est aussi la chance de pouvoir le lire en arabe puisque les deux écritures cohabitent. Les traductrices du texte en arabe sont Rola Sadaki, jeune Syrienne, étudiante à Lyon et la poétesse syrienne Salpy Baghdassarian. Née en Algérie en 1965, Souad Labbize a vécu en Allemagne et en Tunisie avant de s’établir à Toulouse.
Souad Labbize est déjà connue pour son premier roman, Je voudrais être un escargot en 2011 (réd. en 2017 et 2019) et par des traductions de poèmes en arabe de différents pays dont La Valeur décimale du bonheur, 95 poètes d’aujourd’hui, du Maroc au Yémen (anthologie) (Bacchanales n°60, Maison de la poésie Rhône Alpes, 2018). Elle édite sa propre poésie : en 2017, Une échelle de poche pour atteindre le ciel (avec des dessins d’Ali Silem, Al Manar), Brouillons amoureux (éd. des Lisières) et cette année 2019, aux éd. Bruno Doucet, son recueil Je franchis les barbelés. Enjamber, franchir, fabriquer une échelle pour aller plus haut, c’est, d’une certaine façon, sortir du confort trompeur de la coquille de l’escargot, sortir de la spirale qui a avalé la vie. Cette œuvre est en train de construire sa cohérence et elle requiert toute notre attention. Mais aujourd’hui, c’est son récit du viol qui nous retient.
Le préambule est à la fois une alerte et une confidence : « L’évocation de l’épisode fondateur de mes prisons intérieures ne se fera pas sans la traversée des sanglots. Ecrire ne me donnera pas la force de m’exprimer de pleine voix, les mots inconnus de ce drame se sont fossilisés depuis une quarantaine d’années » Tout est là : les larmes, la captivité et l’enkystement, les mots difficiles à trouver pour dire les maux enfouis.
Pourquoi en lisant ce récit, ai-je tout de suite pensé au mythe de l’enfant endormi qui désigne des grossesses plus longues que les neuf mois habituels ? L’enfant serait endormi, en particulier, quand le mari est absent pour une longue période ; et l’on sait que ce mythe a connu une nouvelle activation avec l’émigration maghrébine des hommes vers la France, laissant leurs épouses au pays. Cette croyance est acceptée par la législation islamique et est donc désignée comme une fiction juridique évitant des accusations d’adultère, d’enfant naturel grevant durablement le statut de la femme dont l’enfant se serait endormi dans son ventre. Rarement mais des cas existent, il y a aussi des fœtus qui se fossilisent dans le ventre de la mère. Yasmine Kassari, cinéste belgo-marocaine, en a fait un film en 2005, L’Enfant endormi. Sans doute ai-je pensé à ce mythe dans le sens de son inversion : à cause du rôle que joue la mère dans l’enkystement du viol et donc les années d’auto-gestation qu’il faudra à Souad Labbize pour parvenir à accoucher d’elle-même…
La seconde constante qui peut se lire dans cette reconstitution est l’opacité : « de quel tissu opaque faut-il vêtir l’enfance ? » C’est précisément contre cette opacité que l’écriture avance, difficilement. La première phrase nous prend de plein fouet, d’autant qu’elle reviendra comme un leitmotiv du récit emprisonné plus de quarante années : « Rien de grave n’est arrivé depuis que ma mère a hurlé. Mon récit balbutiant a buté contre l’écho de sa voix. Mes paroles se sont recroquevillées autour de leur noyau, d’autres moins souples ont implosé, semant un arbre à grenades dans les plis de la gorge ».
La petite fille de 9 ans a été violée par un adulte dans une entrée d’immeuble, dans un quartier du centre d’Alger. On est en 1974 : elle rentre, prête à raconter et à trouver des bras accueillants et des mots réparateurs. En lieu et place, c’est le déni de la mère qui l’inonde de reproches et l’esquive du père qui finit de la momifier dans la suspension de la vérité. La dénégation de l’adulte entraîne celle de l’enfant : « il ne s’est rien passé. Cela a failli arriver mais rien ne s’est passé » et l’anéantissement de la confiance envers l’adulte. Le langage métaphorique permet de dire sans dire et remet une fois encore, comme c’est souvent le cas en littérature, en symbiose l’horreur de la réalité et la beauté de la langue. La colère de la mère élimine toute compassion et renforce la culpabilité de la petite fille violée.
Quarante ans après, l’écriture tente d’inverser la force destructrice du refoulement. Le fait est figé, il nie l’écoulement du temps. Rien ne peut s’apaiser. Sans les mots vrais, il n’y a pas de résilience. Des tentatives sont faites mais qui ne surpassent pas la colère de la mère : ainsi le retour sur le lieu de l’acte, le trajet refait ne conjurent pas la peur. Sa mère raconte en arabe, seul le mot « viol » semble être prononcé en français : « Les mêmes souvenirs se déclinent dans les deux langues qui jouent ensemble à saute-mouton. A l’exception d’un seul mot prononcé en français par ma mère, pour raconter, en ma présence, ce que son idiote de fille a failli subir ». Ce mot que la petite file ne connaît pas et qu’elle va confondre avec une couleur, le violet, qu’elle aura toujours en horreur. Définitivement l’espace maternel n’est pas refuge mais repoussoir :
« En évoquant ces instants, je me vois marcher rue Diderot, en pleurant fort. Rue déserte, quartier absent. Je me vois grimper les deux étages en me préparant à avouer à ma mère. J’étais sortie en cachette, pendant sa sieste. Je craignais sa réaction. Certes, je ne m’attendais pas à du réconfort, mais certainement pas à une si grande colère qui m’apprendra à ne plus me confier en cas d’extrême chagrin. Je subirai d’autres agressions, d’autres viols et d’autres tentatives de viols. Personne ne l’a jamais su ».
Elle réalise, en écrivant, que la colère de sa mère a été tellement forte qu’elle n’a pas eu l’idée de se laver ; elle se demande si elle a réalisé ce qui lui était arrivé. Ce qu’elle intègre, par contre, c’est sa « responsabilité » quand la même chose se produira avec un cousin, avec un entraîneur de natation, avec un gardien de piscine, avec une bande de garçons du quartier, des commerçants, des passagers dans les bus bondés : « La seule présence d’une fille était une autorisation en règle pour la palper, l’embrasser, lui pincer un sein ou les fesses. […] Il suffit d’une fois pour enjamber la flaque où se reflète l’enfer séparant l’univers de l’enfance du reste de l’éternité. J’ai alors habité la solitude avec un compagnon fiable, le silence ».
Le récit de la mère se substitue à celui, tu, de la fillette : c’est elle qui a suivi un homme et non l’inverse ; c’est elle qui a désobéi : « Ma mère a continué à ébruiter mon malheur avec mépris, elle se plaignait d’avoir une fille stupide. Aucune des femmes informées n’a eu de mouvement vers la petite fille figée sous la pluie acide des mots maternels ».
D’autres agressions se succèdent racontées avec précision, sans que se dilue le sentiment d’être une « paria », « proie forcément consentante puisque je prenais le risque de sortir seule. Il y a un prix à payer, mais rien de grave… » Ce sont les derniers mots de ce récit qui prend à la gorge et qu’il faut lire dans son intégralité.
L’écrivaine confie : « Yemma est morte en janvier, je n’aurais pas réussi à lui en parler ni à l’aimer malgré l’admiration et la tendresse que j’aie pour le personnage qu’elle a été. Mon courage, je le tiens d’elle, elle a été dure et m’a écrasée mais ne s’est pas remise de ma persévérance à m’arracher à l’image qu’elle a essayé de me donner de moi-même. Je connais beaucoup de mères algériennes (et d’autres !) qui lui ressemblent et c’est de cela que je souhaite parler ».
Dans L’Orient littéraire de juin 2019, Ritta Baddoura a écrit très justement : « Souad Labbize livre un récit essentiel dont la teneur oppose à l’emprise de la fêlure ancienne, un réel élan : autrement fondateur, en mouvement, réparateur et porteur de sens, par-delà le traumatisme. Son récit est remarquable : par son courage et son intégrité. Par sa poésie qui accompagne la douleur, sans chercher à masquer, enjoliver ou tempérer. Par sa volonté extraordinaire d’aller au bout du silence geôlier, afin de dire le viol.
C’est peu dire que de confier qu’il est difficile de lire son ouvrage, encore plus de tenter d’écrire à son sujet, alors même qu’il recèle des trésors de résistance et de possibles repères pour aborder l’univers littéraire et la langue d’écriture de l’intellectuelle Labbize ».
Diakritik