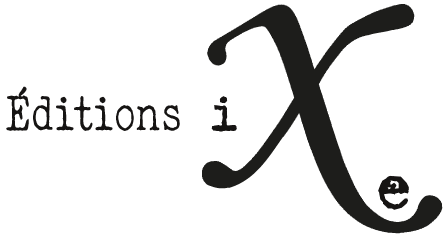L’ouvrage, un recueil d’articles d’Hélène Rouch en son hommage, s’ouvre par un texte politique, « Les navires sont pleins de fantômes », consacré au traitement social de la violence faite contre et exercée par les femmes, à partir de la prise d’otages puis du suicide des membres de la bande à Baader en 1977. L’article frappe tant par la fermeté de son argumentation que, trente-cinq ans plus tard, par l’actualité des constats et des questions qu’il pose, en particulier la question des voies à emprunter pour gripper le système de domination des hommes sur les femmes. Refusant les pièges de l’attente de jours meilleurs autant que l’emprunt des instruments masculins de la terreur, Hélène Rouch propose de « déjouer leurs pièges à la limite, toujours, de leurs règles, qu’ils y perdent eux aussi leurs repères, leur sens de l’axe, leur latin (qui a servi aussi à brûler des sorcières) » (p. 26). Les chapitres qui suivent cette ouverture illustrent parfaitement ce projet.
Une deuxième partie de l’ouvrage, la plus importante, intitulée « Membranes, limites et frontières », permet à la lectrice d’avancer, conduite par l’auteure à travers neuf chapitres qui se succèdent dans un ordre diachronique (de 1982 à 2007), dans la savante et obstinée critique féministe des sciences biologiques qu’Hélène Rouch a développée. L’auteure met au jour l’idéologie sexiste qui concourt à la production de la connaissance en biologie, mais aussi les ruptures avec cette idéologie auxquelles différentes innovations scientifiques pourraient amener. Elle analyse alors les problèmes sociaux qui se posent en conséquence, ceux-ci étant inexactement traduits dans le débat social comme des problèmes « éthiques », ainsi que les modalités de leur résolution qui consiste le plus souvent en une réaffirmation de l’idéologie dominante. N’empêche, les repères sont brouillés, la brèche chaque fois ouverte – même si cette fois le piège, me semble-t-il, est celui de la spécialisation, qui rend chaque brèche peu visible à la majorité.
C’est ainsi que, dans son intérêt passionné pour les processus de la reproduction sexuée, Hélène Rouch interroge des fausses évidences telles que l’identité [2][2] Hélène Rouch montre par exemple, en distinguant les… et la « coalescence » entre sexuation, sexualité et reproduction. À partir de questionnements différemment motivés qu’elle développe dans ces neuf articles, Hélène Rouch « décolle » les uns des autres plusieurs niveaux de sexe qui sont presque toujours confondus.
Le sexe morphologique, défini de manière androcentrique par le pénis, et qui permet d’assigner les individus à l’une ou l’autre des deux catégories sociales de sexe, n’est pas le sexe reproducteur. Ce dernier, qui devient fonctionnel à la puberté, induit la capacité de devenir géniteur ou génitrice – nous y reviendrons. Or, pour devenir géniteur ou génitrice, comme l’illustrent les nouvelles techniques de reproduction (NTR), il n’est besoin que de gamètes mâles et femelles, et de la capacité de gestation. En d’autres termes, ce ne sont pas les corps sexués qui sont en jeu, mais les cellules sexuelles (l’« homme testiculaire » et la « femme ovarienne »). Les gamètes ne définissent en effet pas les corps sexués, plutôt « encombrants » lorsqu’il s’agit d’en extraire les cellules sexuelles. Elles définissent encore moins les rôles sexués puisque « si les rôles reproducteurs sont complémentaires, cette complémentarité est très abusivement élargie aux autres capacités et activités humaines, notamment pour justifier la distribution des rôles sociaux impartis à l’un et à l’autre sexe » (p. 96). Aussi, en établissant une coupure entre reproduction et sexualité, les NTR brouillent le statut sexué de l’individu, à savoir le lien entre anatomie, sexualité et reproduction.
Par ces démonstrations, Hélène Rouch dissocie également sexualité et reproduction : si la contraception a permis une sexualité non procréative, les NTR conduisent quant à elles à une reproduction indépendante de la sexualité. En d’autres termes, l’autonomie de la reproduction par rapport à la sexualité se traduit non seulement par la possibilité de ne pas faire un enfant quand cela est possible (contraception) mais aussi par le choix de faire un enfant quand cela est impossible (NTR). Mais la dissociation entre sexuation, sexualité et reproduction permet de mettre au jour d’autres amalgames. Par exemple celui qui associe individu et espèce : la pathologisation de la stérilité laisse croire que la reproduction est nécessaire à l’individu, alors qu’elle ne l’est que pour l’espèce. Autre exemple, l’amalgame entre sexe et parentalité, des entités qui ne se superposent pas non plus, puisque les individus trouvent une identité de sexe en dehors de la reproduction et de la contrainte à l’hétérosexualité. Ou, enfin, l’association entre sexuation et sexualité, due à l’hétéronormativité.
Bref, en démontrant la confusion entre attributs de sexe, comportement sexuel et rôles dans la reproduction, Hélène Rouch met au jour la prégnance des rapports sociaux de sexe dans les discours scientifiques sur la différence des sexes. La production du biologique lui-même résulte de ces rapports sociaux : « La coalescence élevée entre sexuation, sexualité et reproduction dans les discours censés traiter uniquement des sexes biologiques révèle que ce biologique-là est aussi une construction sociale » (p. 96).
Au cours de ces neuf articles, Hélène Rouch s’attaque également à la fausse symétrie établie par les NTR sur le fonctionnement des sexes dans la reproduction – une réflexion bienvenue dans la mesure où la fausse symétrie entre les sexes (à leurs différents niveaux) est un phénomène contemporain plus général avec lequel les études féministes n’ont pas fini d’en découdre. Si les gamètes ne font pas les individus sexués, leur extraction des corps exige en revanche des procédés différenciés pour les hommes et pour les femmes individuellement concerné·e·s par les NTR. Alors que les spermatozoïdes sont produits en de très importantes quantités de façon permanente et externe, les ovocytes sont cycliques (un par cycle) et internes. De surcroît, seules les femmes assurent, pour le moment du moins, la gestation. À ces égards, les traitements longs et potentiellement dangereux que constituent les NTR sont supportés presque exclusivement par les femmes, ce que pourtant la fausse symétrie de la théorie de la complémentarité dans la reproduction tend à masquer. L’équivalence idéologique entre les sexes n’est cependant plus du tout invoquée socialement quand il s’agit de juger des conséquences des NTR sur les statuts de parents : alors que la pratique de la « mère porteuse » pose un problème social de reconnaissance des statuts respectifs des mères biologique et sociale, les paternités biologique et sociale n’en posent pas. Dès lors, pour Hélène Rouch, la protection des femmes et des enfants invoquée pour justifier les réglementations françaises interdisant la pratique de la « mère de substitution » n’est pas un argument suffisant : cette protection traduit, et masque du même coup, l’ancrage biologique de la maternité sociale, c’est-à-dire l’impossibilité sociale de dissocier la maternité sociale de la maternité biologique, puisque « le maternel/féminin est associé au biologique, donc à la permanence, le paternel/masculin au social, donc au changement » (p. 105).
La troisième partie de l’ouvrage, constituée de quatre textes sous l’intitulé « Lectures critiques », propose, au cours des trois premiers articles, une réflexion sur les manières dont Simone de Beauvoir d’abord, Simone de Beauvoir et Adrienne Sahuqué ensuite et, enfin, Simone de Beauvoir, Adrienne Sahuqué et Suzanne Lilar ont envisagé la question du sexe biologique. Il est intéressant de remarquer que, sous la plume d’Hélène Rouch, les positions de ces trois auteures renvoient finalement à des postures contemporaines toujours sujettes à polémique. Simone de Beauvoir, bien qu’elle ait ouvert le débat sur les rapports entre sexe et genre et qu’elle ait revendiqué l’égalité des sexes (sociaux), présente une posture différentialiste qui (re)produit une hiérarchie et une asymétrie des sexes (des corps) au travers de ses présupposés positivistes et même misogynes. De son côté, Adrienne Sahuqué s’est attaquée à la justification et à la naturalisation de l’infériorité des femmes par la biologie. Elle pousse sa critique jusqu’à envisager que le genre précède le sexe et à remettre en question le dimorphisme sexuel. Son « intuition » cependant est tombée dans l’oubli. Quant à Suzanne Lilar, en particulier dans sa critique du Deuxième sexe, elle a proposé une théorie de la bisexualité originelle qui suggère fortement le continuum sexuel. Le quatrième texte de cette partie est la présentation et la contextualisation, pour un numéro spécial de la revue du CEDREF [3][3] Centre d’enseignement, de documentation et de recherches…, de quatre textes de féministes des sciences (Margaret Rossiter, Londa Schiebinger, Evelym Fox Keller et Wendy Faulkner).
La quatrième partie du livre, « Recherches féministes, pratiques politiques », présente deux projets d’encouragement à la réflexion féministe : le séminaire hors institution Limites-Frontières et le programme de Recherches sur les femmes et recherches féministes.
L’ouvrage s’achève sur le constat que fait Hélène Rouch à l’occasion de sa présence au forum des ONG (Organisations non gouvernementales) organisé sur le site de Huairou en septembre 1995 (donc simultanément à la Conférence mondiale sur les femmes de Pékin) : l’inanité d’une recherche féministe institutionnalisée qui oublierait toute posture militante ou négligerait de s’ancrer dans la solidarité d’une oppression qui, pour autant qu’elle prenne des formes diverses, n’en est pas moins commune à toutes les femmes. Renouons donc, pour finir, avec le premier article de l’ouvrage. Hélène Rouch y dénonce le sexisme des années 1970 et suggère de mener une lutte féministe qui invente ses outils d’appropriation et de transformation d’espaces et de pratiques réservées aux hommes. Cet ouvrage montre que la réalisation de ce projet était aussi pertinente que nécessaire. Non seulement elle a permis de produire un savoir revisité à partir de postures politiques et épistémologiques qui l’ont infiniment enrichi et qui ont offert des arguments de lutte. Mais encore, la critique féministe des sciences, chemin faisant, a permis à des femmes scientifiques de gagner en légitimité de sorte qu’on ne peut plus (ouvertement) considérer l’approche féministe comme mineure et/ou inepte. Cependant, comme le relève Hélène Rouch, certaines dénonciations (comme la violence faite aux femmes partout dans le monde) demeurent lettres mortes, en étant négligées par des tendances actuelles du féminisme institutionnalisé ; de nouvelles difficultés s’imposent alors, comme les effets normalisant de l’institutionnalisation des études féministes. À nous donc de poursuivre la lutte, inspirées, espérons-le, par la perspicacité et l’ingénieuse précision d’Hélène Rouch.