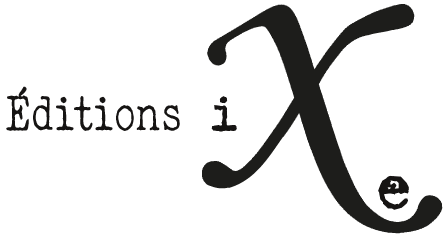Deuxième essai de Manon Labry, Émeutières – Pussy riot grrrls (Éditions iXe) conserve l’écriture personnelle et légèrement écorchée, sous son apparence ordonnée et académique, que l’on avait découvert dans Riot grrrls : Chronique d’une révolution punk féministe (Zones). Il constitue une généalogie du mouvement riot grrrl allant ricocher jusqu’à ce que se forment les activistes russes Pussy Riot.
Au début des années 70, le punk est un mouvement en construction, aux frontières indéfinies. Peu codifié, encourageant l’amateurisme et répercutant la voix des marginaux en tous genres, il devient un terrain d’expression relativement accessible aux femmes. L’émergence de personnalités comme Patti Smith, Deborah Harry (Blondie), Poly Styrene (X-Ray Spex), et de groupes tels Kleenex ou The Raincoats, encouragent d’autres musiciennes à s’y glisser. La démocratisation du matériel et le développement de petits labels permettent aussi à des musiciennes alternatives comme L7, Lunachicks, 7 year Bitch, Babes in Toyland ou Hole d’entrer de plain-pied dans le monde musical encore trop masculin et hétérocentré des années 80-90.
Sensibles aux problématiques queer, les riot grrrls font preuve d’une inventivité et d’une capacité imaginative sans limites pour rendre visible les mécanismes de la domination. Kathleen Hanna peint sur son corps les mots « SLUT » (salope) ou « RAPE » (viol) pour dénoncer l’objectivation masculine lors de ses concerts, Poly Styrene se joue des conventions et porte des couronnes sur ses dents, L7 revendique également cette « esthétique de la laideur ». Les riot grrrls ne cessent de dénoncer l’omniprésence masculine, blanche et âgée, avec une dose d’humour qui rend la misogynie ridicule. Elles s’inscrivent dans une démarche intersectionnelle et tentent de défier toutes les hiérarchies. Loin de couper les liens avec les militantes des années 70, les riot grrrls se considèrent toutefois comme des activistes culturelles. Elles refusent un féminisme trop académique et universitaire. Bikini Kill par exemple, entend « rendre le punk plus féministe et le féminisme plus punk ».
Les riot grrrls mettent en place un certain nombre de stratégies pour s’insérer dans le punk et contourner les étiquetages. La subversion est toujours le résultat de choix individuels. Cette pratique, encouragée par la création de groupes de musique et de parole, de fanzines, puis par l’apparition de Ladyfests et de Girls Rock Camp, permet de mettre en évidence une mosaïque d’identités personnelles au lieu de se fondre dans une lutte collective. Les riot grrrls construisent leur singularité face à l’anonymat du collectif, sans demeurer indifférentes au sort de leurs semblables. En démultipliant les points de vue, elles refusent ainsi de circonscrire le courant qui s’est sans cesse employé à contourner les définitions. « Si chaque fille fait sa propre révolution personnelle, on n’a pas besoin de la grande », disent-elles. Et les réseaux riot grrrls permettent justement de créer du lien : « De proche en proche, par centaines, des jeunes femmes qui se sentaient jusque-là isolées, caractérielles ou inadaptées s’agrègent, s’identifient, s’approprient ces pratiques et ces discours rebelles, les transforment pour créer l’environnement et la culture dont elles ont besoin pour exister ». Les jeunes femmes sortent de leur coquille et créent de nouvelles significations. « Plus les actes créatifs se multiplient, plus les voix qui expriment des positions sont nombreuses, et plus la configuration de sens dominante perd de son autorité », écrit Manon Labry. Diffracter le mouvement, ne pas former un tout homogène, c’est éviter au maximum de donner à « l’ogre mainstream » un produit figé, facile à consommer et à digérer. C’est éviter de se faire engloutir par les médias de masse, symboles d’autorité et de l’ordre institué.
Manon Labry tente de se placer à rebours des récits historiques qui ont forcé le trait en rendant le mouvement majoritairement blanc et de la classe moyenne. Elle accorde une importance au grrrls of colors et aux affinités avec la scène queercore, et montre la continuité du mouvement du punk à l’électroclash (une musique hybride, à la fois électrique et électronique), dans la lutte contre les clichés du cock-rock (littéralement, « rock de bite »). L’autonomie et la capacité de choisir des riot grrrls sont moteurs, indépendamment des dissensions et des rapports de force. Les Ladyfests, les Girls Rock Camp ou les Pussy Riot, prouvent ainsi le caractère transposable et reproductible de l’ensemble de tactiques mises au point par les riot grrrls. Manon Labry nous montre la capacité de ces filles à se régénérer tels des phénix. Elle nous apprend, par sa plume incisive et rigoureuse, que chacune doit faire son propre travail de déconstruction de ce que la société patriarcale nous a inculqué depuis l’enfance, que chacune doit repousser l’aliénation par la création, pour que se révèle un extraordinaire puzzle punk féministe.